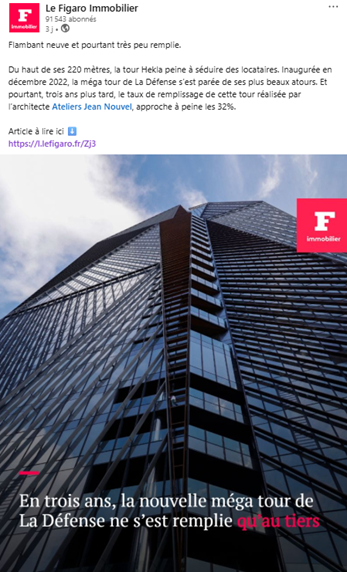Le paradoxe de nos villes modernes
Imaginez : des tours de bureaux vides côtoient des familles en recherche désespérée de logement. Comment expliquer ce décalage ? Et surtout, quelles solutions envisager ?
Deux regards récents apportent des réponses contrastées : le rapport Bouyer-Lépine, remis en septembre 2025 au gouvernement, et l’ouvrage de la sociologue Marine Duros, Immobilier hors sol parus en juin 2025. Le premier propose des solutions techniques pour transformer des bureaux en logements, le second dénonce des logiques financières qui, selon elle, sont à l’origine du problème.
1. L’immobilier : un produit financier ?
Contrairement aux idées reçues, la crise des bureaux vides ne vient pas uniquement du télétravail post-Covid. Marine Duros démontre que depuis le début du siècle, on construit beaucoup plus de bureaux que nécessaire. Pourquoi cette surproduction ?
La réponse tient en quelques mots : l’immobilier est devenu un placement financier comme un autre. Les grands fonds d’investissement – tels les géants comme Unibail ou AXA – ne construisent plus pour répondre à des besoins réels, mais il semblerait que la logique soit avant tout financière.
L’exemple concret de nos métropoles
Prenez l’Île-de-France : pendant que des millions de mètres carrés de bureaux restent inoccupés, de nouveaux projets immobiliers continuent de sortir de terre. Cette logique peut paraître irrationnelle, mais elle suit sa propre cohérence financière : chaque nouveau projet alimente une logique économique qui fonctionne indépendamment des besoins des habitants.
Ainsi, en septembre 2025, le Figaro titrait « En trois ans, la nouvelle méga tour de La Défense ne s’est remplie qu’au tiers – Du haut de ses 220 mètres de haut, la tour Hekla, inaugurée en décembre 2022, s’est pourtant parée de ses plus beaux atours. »
2. Les solutions proposées : traiter les symptômes ou les causes ?
L’approche technique du rapport Bouyer-Lépine
Face à ce constat, les rapporteurs proposent de créer des « Foncières de Transformation de Bureaux ». L’idée ? Faciliter financièrement la conversion de ces espaces vides en logements. Le rapport avance aussi la mise en place de nouveaux outils fiscaux et juridiques afin de sécuriser ces opérations. L’objectif est de rendre ces transformations attractives pour les investisseurs et « fluidifier » un marché immobilier en mutation.
La critique plus profonde de Marine Duros
La sociologue nous alerte : en se contentant « d’huiler les rouages » existants, ne risque-t-on pas de reproduire les mêmes erreurs ? Si on transforme les bureaux vides en gardant la même logique financière, ne va-t-on pas simplement créer de nouveaux produits d’investissement ?
Pour Marine Duros, le problème est plus profond : tant que l’immobilier sera traité comme un simple actif financier, il continuera de se déconnecter des besoins réels des habitants.
3. Deux visions de la ville
La ville-portefeuille versus la ville-habitat
Ces deux approches reflètent deux conceptions différentes de nos espaces urbains :
- La première voit la ville comme un portefeuille à optimiser. Les immeubles sont des actifs nécessitant de fructifier. Dans cette logique, transformer des bureaux en logements devient une opportunité d’investissement.
- La seconde considère la ville comme un bien commun. L’habitat n’est plus une marchandise mais un droit. Cette vision implique de reprendre le contrôle démocratique sur l’aménagement urbain.
Les conséquences concrètes pour les habitants
Cette différence d’approche n’est pas qu’intellectuelle. Elle détermine concrètement :
- Qui peut se loger et dans quel lieu
- À quoi ressemblent nos quartiers
- Qui décide de l’évolution de nos villes
- Si les transformations urbaines profitent aux habitants ou aux investisseurs
Au-delà des aspects techniques, un enjeu de gouvernance se dessine. Qui décide de la forme de nos villes ? Aujourd’hui, une grande partie de ces décisions est influencée par les grands acteurs financiers ou institutionnels, qui orientent les projets en fonction de leurs propres logiques.
Pour Marine Duros, cela pose un problème démocratique : l’aménagement urbain devrait répondre d’abord aux besoins des habitants, et non aux impératifs d’une démarche d’investissement.
4. Vers plus de transparence
La question de la transformation des bureaux vides n’est pas seulement technique, elle est profondément politique. Nous sommes collectivement face à un choix doit-on traiter la ville tel un portefeuille d’actifs à rentabiliser ou considérer celle-ci comme un bien commun, au service de ses habitants ?
Le débat ouvert par le rapport Bouyer-Lépine et par l’ouvrage de Marine Duros qui illustre parfaitement cette tension. Le premier propose d’optimiser un système existant, le second appelle à le réinventer. Reste à savoir quelle vision guidera les décisions à venir – et quelle ville nous voulons construire pour demain.
Informations complémentaires
- Rapport Bouyer Lépine, septembre 2025
- Ouvrage de Marie Duros – L’immobilier hors sol, juin 2025
- Bureaux : la reconversion immobilière simplifiée
Qui est Marine Duros ? Docteure en sociologie de l’EHESS (2022) et professeure agrégée de sciences économiques et sociales au lycée Jean-Monnet de Franconville. Chercheuse associée au Centre Maurice Halbwachs (CNRS-EHESS-ENS), elle est spécialiste de la financiarisation de l’immobilier et auteure de la thèse de référence « L’édifice de la valeur » (2022) et de l’ouvrage « Immobilier hors sol » (2025) cité abondamment dans cet article .